|
|
Revue d'Art et de Littérature, Musique - Espaces d'auteurs | [Forum] | [Contact e-mail] |
|
||||||
Troisième partie - Périphéries des discours
|
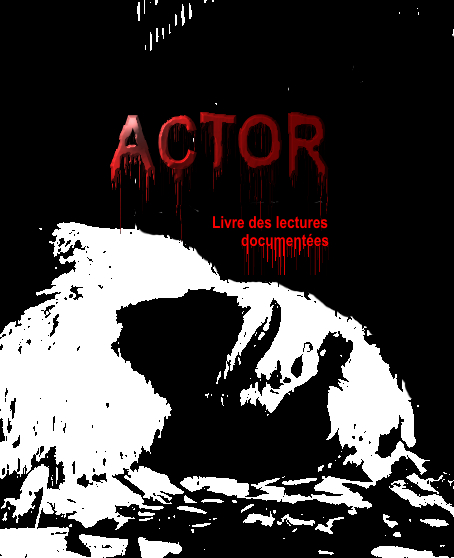
|
|||||
|
| Navigation | ||
 oOo I
Quand Picasso lance à l’esprit son fameux "Je ne cherche pas, je trouve", il ne se contente pas de jeter une lumière cognitive sur son oeuvre, il installe les limites de la conversation qu’il est encore possible d’avoir avec lui. Chercher, c’est laisser aux autres une place telle qu’ils en deviennent les principaux habitants. Passé l’enthousiasme des premiers instants de recherche, vient le temps des contraintes, des sentiments flous et des sautes d’humeur, rien pour alimenter le moindre roman en angoisse sèche. La pyramide des discours nous exclut ou nous réduit à des critallisations précipitées au fond des éprouvettes pour peut-être des expériences dont nous n’avons en principe pas la moindre idée. Vivre à la périphérie, je l’ai montré sans déjà me plonger dans cette matière plus proche et plus indicible pour cause d’une complexité déduite et non pas induite ni conduite, c’est le destin de la plupart d’entre nous et nous nous acquittons plus ou moins bien de ce qui semble être un labeur et non pas une vie. Ici, ou là, la vie nous est arrachée en venant au monde et nous sommes rendus au souvenir et aux crises d’affection dès que la mort nous frappe. Périphérie marquée, à la tangente du discours métaphysique, par la présence obsédante des religions dont le choix nous est limité par l’ascendance et les soumissions à l’État, marquée en-dessous par ce cyberespace qui nous répare au lieu de nous prolonger comme ce serait le cas si nous faisions partie de ce que la France, toujours impériale dans ces distributions, appelle l’Élite (mais comment savoir que nous en faisons partie si les moyens de le vérifier ne nous sont pas donnés avec les connexions ?) Enfin, l’ascension de l’homme au Pinacle est un spectacle distribué sur nos écrans à grand renfort de technologie ou plutôt de ce que la technologie est capable de produire pour récupérer, au profit de nos habiles marchands, ce que nous croyons avoir gagné. Ces promesses de capitalisation, quand elles sont tenues, se limitent toutefois au bas de laine, ne nous illusionnons pas plus longtemps sur nos chances d’accession à la couronne et à ses cours. Ce nouveau triangle, bien à plat dans les marges, est un arrêt d’existence, une quiddité difficile à envisager quand nous en sommes le siège mortel.
III-1 - Périphérie des discours
Nous ne pouvons évidemment pas appeler "discours" ce qui s’y tient de parole. Et nous n’en sommes pas encore au "texte". Sermons, chansons, argumentations que par décence on réduit à l’"argu", conseils, pédagogies du bien et du mal etc. Le Droit promeut les réformes et maîtrise les allégations. La Force ne s’embarrasse pas de principes ou alors du bout des lèvres quand ce sont les mains qui officient. Nous procédons alors par "sociétés" et par "nations". Inutile d’aller plus loin dans cette description : il suffit de mettre le nez dehors pour se rendre compte de ce qui s’y passe et si on ne s’en rend pas bien compte, on est toujours amené à en penser quelque chose. Ce n’est pas que nous soyons la périphérie mais le discours cognitif nous a contraint à la périphérie. Mais avons-nous jamais été le centre de quoi que ce soit ? La science pousse dans notre jardin comme une fleur impossible à cueillir. Inspiratrice des meilleurs moyens de défense qui soient contre cet autre rejeté aux frontières, elle est le bien commun des hommes sans appartenir aux hommes. N’appartient-elle donc à personne, comme le Dieu des hommes est à la fois celui des religions et de chacun ? Réduits, simplifiés à l’état de poète ou de technicien, quand ce n’est pas de marchand aux yeux un peu plus ouverts que les autres, nous n’avons pas droit à cette parole. C’est donc ailleurs que l’inspiration trouve les nouvelles de nos conversations et les chroniques de nos solitudes. Pointe l’idée d’un nouveau triangle :
III-2
C’est par jactance d’écrivain que nous plaçons les textes au sommet, rien de plus. Faites pivoter autour de l’axe et vous ne créerez aucune dramaturgie pour alimenter au moins les contes à dormir debout de nos entretiens télécommuniqués. Ce triangle ne fonctionne pas, comme la pyramide est construite pour tourner rond et comme sa périphérie est crevée pour avoir un sens et pas de périmètre, pas d’allure de figure, elle est périphérie et ne contient pas ce qu’elle contourne.
II
Mais les journaux, comme je les appelle, suffisent-ils à donner une idée, même schématique, de ce que le monde nous réserve à cet endroit si partagé de l’humanité ? - Cette chronique incessante nous éloigne du roman. Elle ne sert pas notre désir d’en savoir plus. Elle nous entretient dans la croyance, dans la publicité et dans le divertissement. Nous en connaissons les médias, plus ou moins. Comme nous sommes les plus riches, globalement, c’est ici qu’on vient au crédit comme nous allons aux emplettes. L’écrivain affine ses droits en retour et le savant y promulgue des promesses qu’il ne tient pas. Les discours s’y vulgarisent et les textes perdent en littérature ce qu’ils gagnent en crédibilité. Nous sommes le lieu de tous les instants. Le romancier y devine le déclin des ressources perdues au fond d’on ne sait quel abîme qui nous multiplie à l’infini par simple jeu. Le savant y rencontre ses éprouvettes et des promesses de rhéologies. Jeux et contraintes nous déterminent à ce point que nous en rêvons. Chronique du Bien qui par mise à niveau nous renseigne sur ce que nous ne sommes pas, la chronique est une ontologie. Là est le bien, semble nous dire le souffleur qui est peut-être aussi notre seul spectateur. Ailleurs, le mal nécessaire, sciences abstruses et sujettes à caution, littératures des voyages sans preuve de voyage. C’est d’ici que nous vivons, comme si la vie se projetait sans cesse sans trouver d’écran pour en arrêter l’apparence d’homme. Arrivés au seuil, nous ne prétendons plus savoir ce que la peur supprime par comparaison. Sommes-nous au coeur de la vie quand nous en parlons quotidiennement ? Quel glissement subtil, ni littérature, ni science, nous approche d’un instant de désir nettement entrevu ? Certainement pas la religion, qui commente l’improbable avec une insolence inadmissible, ni les spectacles trop minutés pour être sincères, peut-être un peu l’amélioration du genre de vie qui passe par l’organisation aventureuse des remboursements de frais médicaux et esthétiques. Peut-être le métal parcouru des frissons binaires qui retrouvent à la fois la mémoire et le calcul. Peut-être cette possibilité de cyberniser l’homme au lieu de l’améliorer comme cela paraît impossible autrement. Nous combattrons les religions sur le terrain de la laïcité républicaine, nous deviendrons tristes de ne pas aller aux théâtres, mais nous donnerons cher pour nous prêter corps et âme aux incrustations cybériennes. L’espoir deviendra notre seule raison de vivre si nous ne croyons plus aux théologies de l’existence et si l’acteur ne nous remplace plus comme nous avons rêvé à tort d’être subsitués à notre morosité d’être en question. Notre monde, qui est le monde si l’on en croit sa persistance géométrique plutôt que son évidence apodictique, procède à ce glissement en pleine conscience de ce qu’il implique de renoncements aux anciennes raisons de vivre qui passent maintenant pour des abus de conscience collective. Et ce faisant, l’autre acquiert toute son importance. Faut-il le démontrer par autrechose que la confiance judiciaire que nous lui accordons ? C’est l’autre qui introduit le métal vivant de connexions croisées jusqu’au tissu de remplacement. C’est l’autre qui agit quand il se met à notre place et nous agissons de même si rien ne nous a condamnés à d’autres mortifications moins prometteuses de renouvellement à défaut de nouveauté. Nous entrons de plein pied dans l’anti-poésie et nous en connaissons la prosodie binaire. Contre-culture ? Certainement pas. Nous n’avons rien contre la culture et toute les raisons de la transformer dans le sens que nous impliquons au temps, celui qui passe et dont nous ne retenons que l’échelle de progrès, à l’exclusion de toute expression de l’immobilité, mauvais souvenir qui ne franchit pas les filtres interposés comme des garanties de fonctionnement. Prosaïsme ? Pas plus. Notre langage réduit l’impasse à une expérience, donc nous sommes, ce que n’est pas, ne peut être l’expression prosaïque. Nous avons l’avantage de comprendre ce que nous voulons, même si le désir ne transparaît pas nettement dans les moments de plaisir. Nous voulons, sans référence au besoin ni au désir. Serions-nous revenus à de plus sages prédispositions à l’existence ? Jeunesse fascinante par sa crédibilité exhaustive. Nos vieux arpions n’en reviennent pas et n’en reviendront pas. Par contre, nous avons trouvé le moyen d’extraire l’homme de son invention, substance d’une nouvelle rhétorique qui n’a de rhétorique que le nom. Règne de l’oxymore et des mélanges moins contradictoires de la réalité avec son imaginaire associé. Abondance des chiasmes en remplacement des constructions grammaticales. Vitesse acquise définitivement dans l’optique du pouvoir. Nous ne devenons pas fous, nous changeons de nature sans avoir pris le temps de comprendre la nature. L’étau se resserre autour du discours cognitif et ce n’est pas pour le presser de rendre ses secrets à ceux auxquels ils appartiennent de droit : nous ne sommes pas en guerre, ce qui nous différencie passablement ; nous sommes, de promêtre. Vos intuitions ne remplaceront pas nos flux verticaux qui remplacerons les frissons du commun des mortels.
Ces cybériens de l’assurance sociale et des équités acquisitives forment le gros de la troupe. On y distingue seulement des caractères. Le romancier est un caractère. Dans un monde où le choix est limité aux cooptations, je tente de savoir à quoi je ressemble et non pas qui je suis. À qui je ressemble, à qui je suis, qui me considère comme étant, comme possession, comme possédé ? Qui s’associe tout en demeurant différent jusqu’à une ressemblance presque parfaite ? Qui ne me ressemble pas au point d’être moi-même ? Jeux de miroirs encore. C’est trop facile, c’est-à-dire trop éloigné de l’exercice abstrait et pas assez proche de la surface même du miroir que j’observe comme si ce n’était pas un miroir. Ces nouvelles me concernent parce que je suis l’autre, parce que le romancier est forcément un cybérien. Passage de ce que je suis à ce que je ne suis pas sans sortir de la périphérie, possibilité réservée aux cerveaux recherchés en haut lieu. Le romancier serait-il un cybérien qui choisit de l’être pour ne pas perdre son sens dans les dédales de la formation scientifique ? N’y aurait-il pas d’autres romanciers pour affirmer l’irrégularité de cette conception élististe du romancier ? Dans ce cas, de quel roman est capable le cybérien ordinaire ? Nous ne le savons que trop, hélas.
III
Le savoir organise son discours recruteur en pénétrant les journaux de son autorité difficilement contestable autrement que par des arguments éthiques que le religieux n’a pas les moyens de contester au point de l’abolir. Il est aussi capable de dénoncer les errances du texte (littéraire). En effet, nul acteur ne va jamais plus loin que sa peau. Cette double action dans la périphérie de l’espace-temps est un chef-d’oeuvre de rhétorique. On y revient, à la rhétorique où le rouge est une couleur et la couleur une vibration etc., au lieu de n’être que la plume à laquelle on l’a arraché pour s’exprimer le plus poétiquement possible. Les raisonnements erronés envahissent notre quotidien et la littérature (ses textes) ne résiste pas longtemps à ces assauts de sens.
III-3
Observez le sourire triomphant du savant exhibant les allégations du romancier et soutenez le regard soumis du lecteur de journaux qui n’a pas les moyens de lire ce que l’aiguille de la balance propose à son esprit véritablement. Quelle est alors la jactance de ce lecteur cybérien ? Toute pédagogie jette le doute sur le texte (littéraire) et renvoie à l’efficacité des sciences en matière de retombées existentielles. Ses moyens de lecture sont une acquisition de l’enfance. Pas question de revenir sur un effort le plus souvent mal vécu, loin de tout acharnement qui signale le poète futur, et inversement proche de l’analyse qui servira à l’insertion sociale avec toutes les chances de son côté. Il faut alors reconnaître les emplois indiscutables de la chose vulgarisée jusqu’à la compréhension sans effort d’approche de ce qu’elle suppose d’extension. La mémoire est à peine sollicitée, l’imagination ne déborde pas le cadre de la fantasmagorie, la personnalité ne présente pas ces différences qui annoncent une douleur trop vive pour être longtemps vécue. Cultiver le cybérien, c’est aussi l’éloigner de l’idée de suicide, sans contrainte, avec science. Car le cybérien est un produit de culture. Mais si la vulgarisation, la mise à la portée est efficace dans la majorité des cas soumis à l’éducation, c’est le doute lui-même qui se retourne contre cette machination du discours cognitif. Le doute redescend pour condamner les acquis au frisson. Certes, un frisson ne garantit pas au texte l’homogéité de l’angoisse qui l’atteste mais c’est une perturbation suffisante pour claquemurer la lecture dans l’espace de la lecture et non pas dans les lieux hantés par les prétextes multimédias. On revient à la lecture comme à une nécessité, même si on ne lit pas, comme on peut croire en Dieu, même si le discours abstrait ne désigne pas clairement une pareille existence. Le texte (littéraire) laisse présager une ontologie du romancier, dans l’espace cybérien auquel il appartient mais aussi au sein de la pyramide cognitive qui s’intéresse de près à l’écriture, en quoi d’ailleurs, on le verra plus loin, elle se gourre. La question, au fond, c’est de savoir à quoi on destine ses propres enfants. De quoi doit-on les protéger ? Du vent d’imbécillité que nous produisons dans nos déplacements intellectuels ? Des égarements que la littérature soumet à l’approbation ? Des restrictions du plaisir dont la science afflige ses chercheurs ? Au fond, nous sommes tous destinés au travail, non pas au labeur dont s’honore tout être humain qui décide de vivre, mais au travail qu’on trouve sans avoir à le chercher ou qu’on ne trouve pas parce qu’il n’y a plus de travail à chercher. L’enfant ne peut pas être perçu comme un prolongement de soi. Il ne nous appartient pas assez pour que cette tentative un peu sommaire de se donner du temps soit couronnée de succès. L’enfant, nous ne le retirons pas de sa solitude. Il est destiné au travail ou à la paresse et aux conséquences de la paresse si durement châtiées par la justice des hommes quand le travail est aussi peu récompensé. Condamné à la reconnaissance des rémunérations et à la faiblesse des revendications, aussi éloignés que possible de l’idée d’un partage des outils de production, nous errons dans la solitude de nos enfants comme si elle nous appartenait. Facile alors de lutter contre le désir si le choix se porte sur le texte (littéraire) avec autre chose qu’un bagage scientifique. Sinon, lire les succédanés du texte et être définitivement un cybérien tranquille ou du moins conforme à l’idée de cybérien. Et quel bonheur quand le cerveau de votre enfant fait l’objet d’une attention de la part des recruteurs de cerveaux capables de ce degré d’abstraction qui demeure pour nous une énigme plus qu’un fait. Je vous dis qu’une ontologie du romancier (de ce que j’appelle un romancier) est possible. C’est à cet endroit particulier de l’homme que l’être se trouverait le plus accessible au langage qui conditionne nos discours. Les paravents de l’existence ne remplaceront pas les hypothèses, que ce soit l’argent, l’extase, la joie, la reconnaissance, le pouvoir, l’espérance de vie etc. La présence du romancier est un signal d’imperfection du système périphérique imposé par une recherche scientifique impossible à désorganiser. Tout cet appui sur le succès, sur les évidences de la pratique, ne soutient pas l’édifice humanitaire à ce point qu’on saurait se passer de toute autre intervention. Le doute demeure la donnée pratique de l’existence y compris quand c’est l’imaginaire qui annonce des solutions. Le doute n’est pas réservé au cerveau en attente de solution. Il est la condition des problèmes, le noeud d’une action promise à l’allégorie ou à l’analyse. On se rapproche du roman chaque fois qu’on doute hors de la pyramide discursive qui affecte la jactance des journaux sans réussir à démontrer l’outrecuidance des romans.
III-4 IV
La position du romancier (de l’écrivain écrivant de la littérature : on pourrait simplement l’appeler un poète) est intenable si ses attendus ne consentent pas à la flatterie. Nous sommes au coeur d’un procès dont la procédure n’est pas littéraire mais vaguement scientifique, quelques-uns diraient cohérente, d’autres relativement équilibrée compte tenu de nos aléas cognitifs question éthique. Le romancier est exclu du débat s’il continue d’utiliser les moyens de sa langue. Il ne dispose plus de ses ressources. Il est perdu. On ne le retrouve que dans les catalogues et dans les biographies du malheur et de la malédiction. On ne perçoit même pas le philosophe à travers la rumeur poétique et les chuchotements aphoristiques. On n’accepte pas la variation de sens auquel le texte soumet les mots les plus porteurs d’objets. Pourtant, c’est dans cette pratique du "glissement", de la "modification" que le texte rencontre sa littérature, plus que dans les modulations de la voix et les persistances physiques de l’image, plus encore que dans les énoncés circulaires où c’est le moraliste qui se donne à penser plutôt que le poète y trouverait sa voix. Glissement, modification, métamorphose, pour dire mieux, mais non pas allégorique ou simplement relative à des analogies. Et puis ce ne sont pas tous les mots que cette prescience affecte de son pouvoir oscillatoire. Les mots sont choisis aussi peut-être pour leur capacité à vouloir dire le sens commun et son contraire. C’est ainsi qu’on touche à l’imagination sans en être la paresse incantatoire. Alors, à qui s’adresse cette jactance de romancier ?
III-5
Le peu de chance consisterait à échouer dans sa tentative de communication (de séduction) malgré les compromis. Le poète qui renoncerait à cet exercice de la caresse dans le sens du poil se condamnerait à l’objet sur quoi ne s’appliquerait pas forcément l’effort de signifiance (il invoque alors des divinités pour servir de doublures au public, il en crée le rituel fortuit et intentionnel, il se noit dans l’incompréhensibilité que l’autre lui affecte). Pourvu que cet objet séduise par autre chose que sa valeur littéraire (intrinsèque) ! Nous demandons au roman d’être lisible et cohérent, voilà ce que nous pensons d’abord de la lecture. La cohérence n’étant pas un gage de lisibilité, nous la limitons à l’équilibre (allégorie de la chaise : sur quatre pieds, elle risque de boîter ; sur trois, elle ne peut boîter mais son assise est peu claire ; sur deux, non seulement elle nous force à l’effort d’équilibre lui-même, mais ce n’est plus une chaise ; un seul pied trahirait notre goût pour les performances inutiles et nous éloignerait de la lecture proprement dite pour d’autres conquêtes - Daumal), un équilibre porteur de sa théorie de la raison qui fait de nous des valétudinaires de l’esprit (âge cassant), des soupçonneux de l’angoisse (âge cassé) ou des jongleurs d’approximations (âge casseur). Appréhension, désespoir, agressivité nous déterminent ainsi plus précisément qu’aucune condamnation. Notre logique, limitée au vrai et au faux, peut-être un peu à l’hésitation ou au droit de ne pas décider, est une jugeote portant à plein poids sur l’existence. Les phénomènes n’arrivent que sur le fil d’une dramaturgie réduite à l’intrigue ou à l’étonnement. Le roman ne se laisse pas pénétrer par ce qui menace sa sinuosité d’horloge. On ne lit que pour se détendre ou pour apprendre à ne pas se détendre bêtement. Des reconnaissances alimentent les ruisseaux et les fleuves de cette pratique du repos et de l’étude dont la fréquence est une affaire de sensation et non pas de rélexion. Il suffit au roman, pour qu’il nous séduise, qu’il soit ce que nous ne sommes pas sans devenir ce que nous sommes. Le moraliste devra donc prendre le pas sur l’analyste si ce romancier souhaite encore nous convaincre de sa capacité à écrire des romans. Un brin d’aphorisme et de poésie ne nous tracassera pas si la mélodie est facile à retenir et surtout à siffler avec les autres adjuvants de notre résistance au monde et à son principe de suicide immédiat. Nous ne désirons rien d’autre que la survie, nous remplaçons l’espoir par l’attente d’une amélioration de notre genre de vie qui, pensons-nous, passe par celle du genre d’homme que nous sommes. Techniques alimentaires avec quoi le roman n’est pas à l’aise. Il en vieillit. Une lisibilité plus exigeante accroîtrait-elle les chances d’avoir écrit un bon roman ?
V
Il faudrait faire entrer de force un jargon étranger à la langue. Certes, il s’agirait toujours d’un langage mais la langue se croit seule. Elle n’accepte pas les traductions qui s’accroissent de mythes étrangers à son histoire et perd une bonne partie de ceux qui inspirent le choix des mots. Elle repousse les intrusions des patois stylistiques sans doute plus propices à la clarté pourvu qu’on sache de quelle clarté il est question. Ce n’est alors plus l’illisibilité qui nous condamne à cesser de lire ce qui est pourtant parfaitement cohérent. C’est l’hermétisme du flux gagné sur d’autres langues et sur une technique de la proposition que nous ne connaissons pas faute d’en posséder les clés. Le roman savant nous échappe et nous le rejetons avec autant de force que le roman poétique. Là où le poète revient, nous n’agissons pas différemment que le lecteur savant face aux apparitions impromptues du philosophe. La langue force le respect. Elle revient à la nation. Nous rendons la pareille à des intellos en leur retournant leurs cachoteries, ne sachant pas distinguer le vrai du faux sinon nous ne serions pas voués à l’amateurisme. Nous ne nous reconnaissons mutuellement que sur le terrain des préoccupations. Indifférence, oubli, tranquillité, nous nous opposons aux arithmomanies des connaisseurs qui trouvent que nos romans préférés manquent de profondeur. Sentimentaux par nature, nous limitons l’obscurité à l’inconnu sans en faire l’historique. Ces plongées de la logique dans notre quotidien ne modifient pas notre comportement ni nos successions. Ils n’écrivent pas des romans de l’éducation, ils jonglent avec leurs propres connaissances. Ils jouent autrement mais ils jouent. Nous sommes différents à ce point. Mais que cherchent-ils en nous quand ils nous proposent les complexités de la cohérence ? À nous convaincre de leur supériorité intellectuelle ? Sans doute un peu. À réveiller en nous des dispositions dont nous n’avons pas la moindre idée ? Pourquoi ? À provoquer le poète qui se cache derrière le moraliste ? À dénoncer la philosophie (elle n’est plus que cela) qui couve sous les prétentions à une métaphilosophie ? Que nous disent-ils du poète que nous ne sachions déjà ? Notre documentation nationale est la même. Qu’en connaissent-ils plus profondément, plus facilement ? Au nom de quoi agissent-ils dans cette ombre pénétrable mais dont le sens demeure aussi caché que les différences d’adaptation au discours cognitif sont inexplicables ? Surtout, pourquoi nous rejoignons-nous si différemment à l’heure de condamner le poète à l’aphorisme ? Nos romans, les faciles comme les savants, connaissent ces mordications (des titillations) constantes qu’il est si difficile d’oublier, auxquelles nous ne sommes pas vraiment indifférents, qui nous menacent d’intranquillité, et auxquelles il nous arrive d’accorder toute notre attention pour nous la reprocher ensuite comme si un moment d’absence ne valait pas tout ce que le moment peut donner à exécuter. En celà, nous nous ressemblons, amateurs et apprentis, juges et sorciers. Nous-mêmes, que sommes-nous pour ces reflets d’ignorance ? Qu’en pense le poète qui se cache en nous et hors de nous ? Réussir à lire la cohérence illisible ne revient-il pas à ne pas lire la lisibilité cohérente ? Qu’en dit le poète quand il annonce une trouvaille ? Il faut bien que la découverte nous change puisque nous n’avons pas d’influence sur la découverte. Notre ignorance ne consiste-t-elle pas à ne pas avoir les moyens de savoir ce que le poète injecte dans les cerveaux capables de découverte ? Au fond, le roman savant n’est-il pas moins anti-poétique que le nôtre ? S’il l’est, ce sera sans nous. Mais est-ce avec le poète ? Qui est-il ? N’est-ce pas lui, cet autre qui n’est jamais personne et qui est tout ce que nous pouvons percevoir dans les passages de miroirs à la surface du monde ? Les savants n’utilisent pas de miroirs pour savoir et pour augmenter la connaissance. Ils ont la mémoire de l’expérience. Ne sont-ils pas au seuil de la poésie ? Les poètes sont-ils savants à ce point ? Ne sont-ils pas les envoyés de cet autre côté où nos fils menacent de vivre si nous ne réussissons pas à leur inculquer notre ignorance ? Ici, tout devient obscur chaque fois que nous persistons dans la réflexion. Parle ! disons-nous au savant. Que sais-tu exactement ? Mais quelle question essentielle nous pose-t-il, lui ? Nous n’en savons rien. Aussi nos romans ne sont plus le récit. Chroniques, ils sont à la mode ou ne sont pas. Ils se vendent, comme le serpent se mord la queue sans rien changer à son destin de serpent qui se mord la queue. Entretenus (sans doute) dans la bêtise et reproduisant sans cesse la bêtise acquise par on ne sait quel dénouement biologicoculturel dont le récit n’est pas le roman, nous alimentons sans nous abreuver nous-mêmes. Nous sommes l’emploi et ils possèdent les ressources. Pour quel profit qui n’apparaîtrait plus aussi clairement que quand on y réfléchit ? Impossible de franchir la barrière du sens caché en se mettant à notre place, hein ? Mais alors, quel jeu joues-tu, poète, entre nous que tu connais parce que tu nous appartiens comme fils et eux qui sont nos autres fils et qui ne reconnaissent pas ton utilité comme nous l’accepterions les yeux fermés si tu consentais à être compris et non pas reconnu ?
Parle. Peu importe qui parle et moins encore de se poser la question en plein coeur d’un roman ou de ce qui veut y ressembler. Une application d’infini ne décrit pas plus que la déposition de lumière sur l’objet du regard, pas plus que la disposition exacte de la statue dans sa lumière inévitable. Si je rature toute cette écriture, tout ce que j’ai consacré à l’autre pour le surprendre en flagrant délit de présence, tout ce que l’apparence de ses gouttes a multiplié au sein même du texte qui le trouve toujours où on s’attend à le trouver, immobile et consentant, cet effacement condamnerait le texte à un crachotement aphoristique, à une décrépitation d’écailles de mots, à des points de rupture où le visage demeurerait persistant pour signaler le personnage, à tout un arsenal de bonnes intentions, bonnes à refaire le texte selon une classification méthodique, un moyen de soutenir le regard sans ciller, la propriété intellectuelle prolongeant le Droit comme l’épouvantail provoque une panique médusée chez les oiseaux du jardin. Cette tendance minimaliste affecte la critique avec le même effet de trou percé dans la perspective que la biographie née du désir de revenir sur les lieux en visiteur connaissant l’air qu’on y respire encore longtemps après que l’auteur a rejoint la poussière, s’il survit à son abondance, à ses circonlocutions, à sa prudence de vis dans la fibre même de son sujet. Parler, c’est écrire.
VI
Que nous propose donc ce premier des cybériens qu’est le poète ? On pourrait aussi évoquer les vaticinations de cet autre cybérien qu’est le philosophe toujours un peu moins philosophe mais philosophe au bout du compte. Combien de cybériens exogènes s’interposent encore entre moi et le romancier ? Où en est l’endogénéité de l’autre dans ces cas de différence infime ? Limitée à l’action, la possibilité d’existence (le renoncement au suicide) tient peut-être au plaisir, au récit, à l’infini, à tout ce qui permet de tirer un fil conducteur entre la vie et la mort, par accoutumance aux apparitions du rêve et de la réalité qu’il semble désigner, avec ce que cela suppose d’obscurité, d’obscurité relative à on ne sait quel mouvement qui serait le périple et la bataille. Croire ou ne pas croire, c’est la seule question à poser en réponse à celle des améliorations existencielles qui justifient et fondent nos recherches. Mais ici, à la périphérie, nous ne cherchons pas : nous agissons ou nous trouvons, selon qu’on est poète ou lunatique. C’est la seule différence. Et c’est la pratique de l’écriture qui rencontre du nouveau, parce ce qu’elle est la parole et la nature de la parole, qu’elle ne s’éloigne jamais trop de la conversation, qu’elle est capable de jouer tous les rôles pour arriver à ses fins, et si rien ne nous propose une identification sensible, nous nous sentons volés par vice du consentement. Notre immobilité de cybériens de base a son explication dans la rupture de ce contrat tacite entre l’écrivain et le lecteur.
L’écrivain ne dénoncera pas les agissements du lecteur autrement qu’en se sentant incompris ou mis en demeure de changer de texte sous peine d’une réduction au silence, comble de l’enfermement à vie. L’écrivain (poète) n’a pas la vision du contrat, elle est le fait du lecteur en proie à des fantasmes de fatalité. Ce que signe le poète n’est pas un échange de bons procédés. Capable d’approcher la parole aussi près que possible du désir qui la soulage de la perfection, il n’engage pas la conversation, il en donne le spectacle commode c’est-à-dire lisible jusqu’à un certain point qu’il n’est pas si difficile de situer. Point qui n’est pas pivot mais limite. Rien n’est totalement illisible pour nous désigner clairement ce qui pourrait l’être, rien n’atteint l’incohérence qui pose la question de la cohérence. Nous n’atteignons pas les extrêmes ni de la raison ni de la déraison. Nous sommes circulaires, quelquefois (rarement) jusqu’à la folie. Le texte est porteur de ces approches et de ces approximations. Il n’est pas possible de n’y rien trouver à son goût, de même que les abstractions dominantes du discours cognitif ont quelque chose de ce que nous connaissons sans les comprendre ni surtout les pratiquer. Cette lutte du cybérien de base avec ses poètes ne repose pas sur la raison, c’est donc qu’elle annonce une dérive du sens vers son oubli. Mais le poète ne veut pas oublier. En cela, il est historien. L’Histoire tient à sa place dans le texte poétique, avec ce que cela suppose d’interprétation, de fragilité émotionnelle, de recours à l’ambivalence des anecdotes. Le poète moderne écrit comme un philosophe, au jour le jour, ne raturant pas, reprenant, perdant le fil de l’oeuvre d’art qu’il se proposait de mettre en lumière vu sa connaissance du sujet. Réduire le texte à des proportions raisonnables, c’est en proposer les ratures comme on va à la pêche des moments indiscutablement poétiques et des traces aphoristiques qui en constituent peut-être les vivants piliers. Si la philosophie perle de l’espace cognitif comme les gouttes d’un fruit qu’on presse pour n’en conserver, à titre cognitif, que la structure, c’est sur la poétique qu’elle laisse sa trace d’escargot. Et si l’oeuvre poétique n’apparaît toujours pas malgré l’attente légitime de ses détracteurs, ce sont des gouttes de philosophie qui changent sa destination en imposant le travail des jours à la place de celui de l’art. Il n’est pas difficile de trouver au moins un instant de bonheur intellectuel dans ce vortex lent qui affecte les endroits les moins tranquilles de la périphérie cybérienne, c’est à dire de l’autre. Ce qui provoque la rupture du contrat, ici, ce n’est pas que la poésie est porteuse du vice, mais que le lecteur potentiel ne prend pas le temps d’y déceler la goutte de sens qui concerne son incompétence et sa pose. Aux questions du connaisseur : Que voulez-vous dire ? et : Comment nous y prenons-nous pour connaître ?, le cybérien, qui les retourne au poéte, ne perçoit pas la pertinence des questions qui lui sont proposées en réponse : De quoi parles-vous ? et : Comment parlez-vous ? Toute l’ambiguïté vient de ce que le cybérien se prend pour un savant et qu’il exige que le poète ne soit pas autre chose. Or, le poète, espèce agissante même dans les pires mortifications, est avant tout le siège de la manière et du sujet et non pas le parangon des raisons et de l’objet. En se prenant pour un savant inadmissible, le cybérien de base condamne la poésie à la poésie, c’est-à-dire à l’intégralité de l’écriture qui a été mise en jeu pour en arriver à cette profusion qui passe pour de la débauche. Arrivé tout droit des centres de recherche, le philosophe est responsable de la manière poétique, pour ne pas dire de la poétique elle-même, et des tournoiements d’objet qui environnent le texte poétique non pas pour le rendre flou mais le rendant flou parce que le travail est visible. Mais qui peut distinguer le sujet de l’objet avec toute la clarté que l’esprit commun voudrait imposer à ses enfants ? La poésie n’est pas un bon entrainement à l’admissibilité. Sans être l’inspiratrice du suicide en réponse à la candidature, elle n’existe que comme autre choix d’existence. Elle explique trop la liberté et pas assez le dévouement. Elle est la quantité inamissible. VII
S’il s’agit maintenant de distinguer, dans cette périphérie cybérienne (Cybérie), les satires des leçons de choses, trois types de discours semblent participer à sa lente cinétique : - le poème (qui deviendra, on le verra plus loin, roman) ; - la leçon de choses données ------------- aux poètes ; ------------- aux autres ; - le texte philosophique : ------------- son axiomatique ; ------------- ses descriptions sujettes à caution ; ------------- ses conclusions indiscutables. Une quatrième option semble toutefois se détacher de l’ensemble : le texte des fausses sciences : ------------- comme pratique des scientifiques eux-mêmes quand ils sont en quête de financement ; ------------- comme argumentaire commercial plus ou moins sincère participant à la force de vente des produits et des pratiques miracle.
VIII
En constatant, sincèrement, que les sciences ne reposent pas sur l’exactitude de leurs principes, ce qui peut vouloir dire que leurs principes fondateurs sont douteux (action philosophique), Freud, savant incontestable dans d’autres domaines que la psychanalyse, tente de nous faire croire que nous sommes dans l’obligation morale et pragmatique d’admettre qu’une science peut exister et se développer sur ce qui n’est plus une intuition mais une sensation, une appréhension de la réalité. Une science qui aurait pour origine soi, qui ne serait pas renvoyée par l’objet mais qui émanerait du sujet. Ce confortable après-positivisme, en jetant le doute sur une vérité, en constitue une autre apparemment tout aussi valable, mais c’est là le domaine des phénoménologies, ce que n’est pas la psychanalyse. Cette stratégie de la pensée ne diffère en rien des maïeutiques religieuses mais la sincérité du propos n’est pas véritablement mise en cause par cette ruse de guerre. Par contre, quand on opère un glissement calculé de l’interprétation à la science, avec le plein accord de Freud qui sait, par expérience, que son discours n’est pas recevable en milieu scientifique, pour toucher le marché beaucoup plus prometteur des pratiques alternatives, ce n’est pas tant pour le pénétrer que pour s’en assurer les revenus nécessaires à la poursuite des recherches. Cette fois la ruse est un calcul inspiré par les circonstances et non plus par la situation. Cette double postulation est le propre d’une philosophie ; ce n’est pas la psychanalyse qui est une philosophie, c’est le fait de trouver les moyens de lui assurer un avenir et par là un devenir d’être. Le texte philosophique paraît exercer son influence dans les deux sens qui lui sont proposés. Participant à la périphérie du discours cognitif, il n’en est pas moins tributaire de l’économie que le monde cybérien fait peser sur tout ce qui existe, y compris d’ailleurs la recherche scientifique. Je ne connais pas (pas encore) le moyen de tempérer ce jugement mais son imprécision ne remet pas en cause ce qui s’en déduit. Le texte philosophique s’adresse, et c’est là son peu d’universalité, autant au cybérien qu’au savant : ------------- Au cybérien il demande d’agir, ce qui revient à un effort éthique, à une philosophie-conseil en passe de devenir philosophie-droit ; les faits, les apparences sont jugés sous l’éclairage des appels à l’ordre, ce qui trahit une certaine sagesse ; il s’agit à la fois d’une critique de la conduite et d’une pratique anticipée de ce qu’elle devrait être pour calmer les jeux en présence, jeux dangereux, immoraux, passibles de reproches judiciaires etc. ; dans ce sens, le texte philosophique tend à devenir une promesse de bonheur imitée de l’ordre ; siège des fausses sciences, et promoteur de leurs effets placebo, ce texte particulièrement audible et de plus en plus compréhensible, s’est dégagé de ses tendances à la poésie et à la construction aphoristique ; il est un exemple de douce rhétorique. ------------- Au savant, le texte philosophique propose sa critique des logiques d’une part, et de l’expression écrite d’autre part ; en surface, le philosophe agit en conseil dès que le savant prétend, lui aussi, s’adresser au cybérien pour le convaincre de financer encore ; cet effort linguistique est récompensé par la clarté littéraire qu’un savant est en principe incapable de jeter sur ce qui est pourtant cohérent et parfaitement expérimenté ; en profondeur, et comme fruit de l’expérience littéraire, c’est dans le domaine des logiques que le philosophe s’installe, aux antipodes de la physique sans doute, malgré des efforts pour participer aussi à l’exploration de la physique, mais parfaitement ancré à l’élaboration constante du discours cognitif dont il contrôle à la fois la vulgarisation et l’exactitude logique.
IX
La philosophie ne discourt plus sur l’action, sauf pour la moraliser, ni sur la connaissance, sauf pour lui donner la parole. Elle apparaît désormais comme cet espace des transmissions nécessaires entre le monde cybérien, royaume de l’ordre, et celui des sciences, c’est-à-dire du pouvoir. Est-il possible de séquestrer le savant, ses apprentis et ses pédagogues pour s’emparer du pouvoir ? Mais bien sûr. Et la philosophie, débarrassée définitivement de ses postures scientifiques et métaphysiques, réussit au moins à nous convaincre, privilège encore en usage naguère dans les pratiques littéraires et satellites du texte (littéraire). Plutôt qu’une fausse sciences, ce serait une science de l’approche de tout ce qui concerne le sujet, un moyen purement rhétorique de d’inventer les phénomènes échappant à la curiosité scientifique, d’en disposer le plus librement possible, nuance peu rhétorique mais décisive, et d’en fabriquer, à défaut d’un discours ni même d’un texte, l’élocution qui prélude aux innovations esthétiques tirées autant des sources scientifiques par l’application technologique que de la bêtise humaine mise au spectacle de la vie quotidienne. De coupure épistémologique il n’y a pas eu, on s’est plutôt, sous la houlette des apôtres de la modernité comme fin et début, contenté d’un retour aux constatations dualistes : ------------- On a trouvé le point commun du malade mental et de l’homme sain ; dans cette limite floue de la distinction, il est question d’un Inconscient qui devrait l’évidence de son existence à l’examen clinique et non pas à des spéculations pas toujours faciles à débrouiller. Ce que nous savons de cette découverte coupante est discutable seulement par la référence à une physique totale, critique justement qui met la physique en demeure de se justifier dans ce domaine invisible. La physique est tellement liée au visible que l’invention de ses outils ne concerne que les moyens de voir et nous ne disposons pour cela que d’obscures vibrations soumises aux caprices du probable. Plus adéquate, mais sans fin, une métaphysique, qui voit le visible donc sans le montrer, se condamne à l’invisibilité parce qu’elle manque d’outils, tous verbaux, tous propositionnels, pour atteindre le seuil de la cohérence. L’Inconcient ne craint donc pas grand-chose. Peut-il craindre l’ironie ? Elle viendrait de l’homme sain en proie aux manifestations de la folie, panique inexplicable aux retombées philosophiques. Comme l’idée de Dieu, cette idée, qui repose sur la découverte, qui échappa à Charcot et à Breuler, de ce qu’on a fini par appeler le transfert, ruse des insconscient mis en présence dans les psychothérapies. Gare à la psychothérapie qui n’en tiendrait pas compte au moins un peu, au moins de temps en temps. Idée, cependant, qui marque sa date et ses circonstances, alors que celle de Dieu semble appartenir à tous les temps et à tous les lieux de la présence de l’homme, pour ne pas dire de son existence, de son voyage. ------------- Autre distinction polarisée, celle du riche et du pauvre, résolue en son temps par le porte-parole le plus durable, à cheval sur le dos de saint Jean, de la pensée messianique : Jésus. En entrant dans la modernité, ce distingo s’éclaire d’une idée peut-être moins durable, une idée peut-être essentiellement pragmatique, en s’attaquant au bien commun du riche et du pauvre : l’outil de production de la richesse, laquelle produit aussi la pauvreté si l’on ne partage pas son outil. Idée séduisante plus que définitive, elle n’a pas trouvé le moyen de ruser avec l’existence. C’est qu’on peut s’entendre assez facilement sur les moyens de l’ordre auquel tout être humain aspire naturellement ; tout aussi naturellement, le pouvoir lui vient à l’esprit, soit par soumission, par tactique du désespoir, par empêchement du suicide, soit parce que l’occasion se présente, par héritage, par droit, par conquête. Comme il n’est guère possible d’imposer le partage du bien simplement en mettant de l’ordre dans les affaires publiques, c’est au pouvoir que revient la charge et on conçoit alors difficilement qu’un tel pouvoir puisse respecter les règles démocratiques. On sera donc difficilement marxiste sans être aussi léniniste ou autre chose dans ce goût. Si coupure il y a eu, c’est dans l’écrasement de l’homme et non pas dans sa "participation" (idée goguenarde) au bien commun mais inéquitablement partagé. Tout tournée vers l’État, tournant le dos à l’homme, cette idée n’a finalement touché qu’à l’Histoire, en la rendant invivable au jour le jour. ------------- À l’opposé, n’en déplaise à ceux à qui le personnage de Nietzsche inspire le respect ou la pitié, on ne partage plus grand-chose. Le fort est fort, mais non content de l’être, ce qui lui assure le pain quotidien en âme et conscience, il est pur. C’est qu’il est créateur. Il n’atteindrait pas la pureté s’il n’était pas créateur. Et comme la créativité est une affaire de goût, on peut alors imaginer, clés en main, ce que cela finit par imposer à l’homme faible, de souffrances certes, mais surtout de ressentiment contre quoi l’homme fort devra employer toute sa pureté pour lutter efficacement. Car l’homme fort n’est pas tranquille. Son extase est ailleurs. Ici, le pouvoir n’est pas une conséquence mais un droit naturel. Cet entretien délirant de la différence non seulement chez l’homme fort, qui paraît alors plus facilement convaincu, que chez l’homme faible qui ne possède pas les moyens de révolte, est la description d’un combat ou plus exactement le portrait d’un héros aux prises avec, non pas le malheur, mais l’infériorité. Le discours cognitif trouverait là le décorum de ses vulgarisations, que ça ne nous étonnerait qu’à peine. Avec un peu de pitié, ou de condescendance, pour nuancer les circonstances héroïques du combat symbolique entre le fort et le faible, on a mieux fait de convaincre l’homme du commun qu’avec des promesses d’équité, d’autant que la preuve de l’outrecuidance de ce prétendu partage est faite par l’Histoire. L’Histoire montre aussi, par le même effet de sang et de fumée, qu’il ne faut pas exagérer non plus du côté de Nietzsche.
X
Au bout du compte, et passée la tourmente sans toucher à l’universel, la question est de savoir ce qui reste de cette idée de coupure épistémologique, idée séduisante par sa simplicité et par ses promesses textuelles. Le sectionnement de l’Histoire en siècles plus ou moins exacts ne vaut pas tripette et ne fait pas long feu même en territoire pédagogique. Comme on tronçonne la vie en périodes pour l’éclairer de la géométrie de sa parabole, il est tentant d’offrir à l’esprit des segments qui, à défaut de s’emboîter les uns dans les autres comme les fils conducteurs d’un circuit linéaire (une transporteuse) qui fait l’objet de notre observation crispée, des coupures, sans rien expliquer de la coupure ni des dérivations qui y plongent on ne sait le plus souvent quelles destinations occultes ou occultées, des coupures divisent la quantité et mettent de l’ordre dans ce récit compliqué d’effets de suppositions et de désirs de convaincre. Pratiques, les coupures, surtout si on ne possède pas les moyens de couper à volonté. Des prophètes, des visionnaires ne se laissent pas leurrer par ce présent, par cette durée impossible à comparer avec la durée cognitive. Et du coup, nous appartenons à notre époque comme si nous en étions les acteurs et les clercs ou seulement les cybériens de base, ces autres qui sont peut-être tout ce qui reste de l’autre quand nous avons fini de penser pour nous livrer pieds et poings liés aux vortex de l’existence. Pas étonnant que les Mathématiques aient fini par se hisser au sommet de toute réflexion un peu élaborée ou simplement profonde. La réduction, en gros, de l’extension à la compréhension, non seulement satisfait à la plupart des besoins (titre que j’aurais aimé poser en tête d’un de mes livres pour en étirer la matière vers cette Plupart du temps qui revient comme le meilleur de la poésie) mais encore et surtout elle assoit la pensée avant de la développer, sinon le foisonnement devient matière et non plus idée. La tentation est de faire au plus simple (limite du texte) et au plus vite (limite de l’existence). La formation d’un système en collier de perles demeure alors la seule raisonnablement possible, étant entendu que tout dérèglement de l’effort ne favorise pas la compréhension ni la contemporéanité. Un système peut toujours se résumer à un pointillé ou à tout ce qui peut se représenter comme pointillé (déchiquetage des bords, trous de la surface, côtés du miroir, séquence, frittage, ricochet etc.). De pareilles représentations, car au fond il ne s’agit que de cela, sont bien pratiques mais ce ne sont que des pratiques et non pas des expériences. On ne peut donc en vérifier la pertinence. Fonder une organisation (un ordre) des sciences sur une pareille improbabilité relève de l’aventure et non pas de la recherche. Il n’est donc pas étonnant qu’en haut-lieu scientifique, on ne se préoccupe pas de savoir si l’Histoire se coupe ou s’il est préférable de la raconter comme une intrigue. On voit là tout ce qui relie la littérature à la réflexion philosophique, et plus particulièrement le roman à la curiosité extra-scientifique. La poésie moderne, qui doit tout à Vigny et peu à Rimbaud (qui influence plutôt la chanson), est un désordre et par conséquent il n’en est même pas question, dommage : car c’est peut-être là qu’on dérive ou qu’on peut se faire, sinon une idée, du moins une sensation aussi nette qu’une idée et aussi facile à transporter. Notre époque, mais c’est le cas de toutes les périodes, est religieuse, profondément religieuse, ignominieusement religieuse quand plus d’un homme lui confie sa destinée, sa postérité génitale, les objets de son art et/ou de sa science et le concours extravagant de ses doctrines durables. Elle aurait pu être théâtrale s’il n’était pas si difficile et surtout si douloureux d’en être metteur en scène sans passer pour un poète, comble de la mise en scène. Elle eût été populaire sans la peur et le désir du lendemain, sans cette poignante réserve de vie quotidienne qui propose ses refuges mentaux en guise de centres de traitement des maladies mentales.
C’est plutôt la permanence des faits qui doit fonder la philosophie et non pas ce lent et rapide grignotement joffrien qui détruit la vie par soustraction de l’identité. Le textualisme des philosophes alimente ses hypothèses, il ne se prononce pas sur la vie. Facile alors de plonger l’homme dans un bain de substances et de lui demander, quand on ne l’y force pas, de respirer l’air d’une surface surmontée de la voûte céleste et de ce que Dieu seul sait ce qu’elle contient et ce qu’elle signifie pour nous, pour notre croissance et notre multiplication. Débarrasser le texte, et donc la parole, de cette fragmentation en apnée et en halètement, est la priorité des philosophies un tant soit peu soucieuses de préserver à la fois leur enrobage de la chose scientifique et leur pouvoir de transparence dans un sens comme dans l’autre entre le cybérien et le savant. Nouvelle dichotomie, en remplacement du malade et de l’homme sain (Inconscient), du fort et du faible (Puissance) et du riche et du pauvre (Production), plutôt ramification que division, et en tout cas peu favorable à l’dée de coupure : le cybérien (nous) et le savant (l’autre) et inversement. Le point de rencontre se situe dans le discours philosophique sans être toutefois le discours philosophique. Et au lieu de provoquer une lutte des classes, des guérisons problématiques et des concentrations à éliminer, on revient à la philosophie, tout simplement, sachant qu’elle n’est plus la dominante mais la médiante. Philosophie non-textuelle, qui appelle le texte mais sans être le texte. Faire joujou avec les outils du poète n’était pas une bonne idée philosophique. On s’est peut-être laissé posséder pour mieux fragmenter les objets du désir, mais il n’y a eu ni texte philosophique ni poème, pas même un récit circonstancié de ce qui est arrivé, un moment, au langage. Imitation des impasses dont le phénomène est bien connu en littérature. Il fallait le tenter, sans doute. Il faudra désormais interroger les tentations car c’est à cet endroit de notre nature humaine que nous perdons du temps sans en connaître l’unité alors que nous éprouvons en même temps le désir de le mesurer. Joujoux de l’Inutile et non pas de la Poésie qui est terre-à-terre, j’allais dire : prosaïque.
XI
Il faudra lire CARABIN CARABAS non pas comme une démonstration romanesque de ce monde tripolaire où le savant (Carabin, on l’aura compris) et le cybérien (Carabas) communiquent à travers les philtres d’amour et d’autres augures que le texte philosophique promet lui-même au romancier en mal d’inspiration. Ce mal est sidérant, suite peut-être à un anéantissement de certaines données vitales qui restent à découvrir mais qui ne révèlent à la fin que l’empressement qu’on peut mettre à accepter la dernière douleur : le vieillissement, et non pas leur historique de croissance biologique. Quand une impasse littéraire ne se conclut pas par l’attente tranquille ou par l’éblouissement des reflets renvoyés par le regard des autres, d’impasse elle devient oubli, même ayant été à la mode. L’expérience littéraire ne trouve ses compléments de durée que dans le regard porté sur le bonheur, thème qui devient vite la principale sinon la seule question philosophique pertinente. On en revient donc à la question de l’eugénisme, on se rapproche de Nietzsche plutôt que de Freud, l’amélioration de la race devient l’objet de toutes les caresses aux mots, Carabas est le faible plutôt que le malade et Carabin, qui recueille les mots, est le fort que la haine du malade menace de destruction. L’objet du désir est destruction, par les mots ou par l’enfermement. On assiste alors à un combat, comme dans un rêve où le corps n’est plus soumis aux contingences physiques. On est dans un lieu métaphysique où la métaphysique est impossible. Impossible à comprendre ou impossible à accepter comme métaphysique. Le texte devient littéraire, visiblement parce qu’il ne ressemble à aucun autre, et clairement parce qu’il est effectivement porteur des données du combat et non pas de son épopée, ni de ses chants, ni de la maturité qui marque le pas devant les premiers signes de vieillesse.
III-6 - Expansion du roman
XII
Dans une de ses innombrables conversations accordées aux médias de l’information, Ana María Matute présente le roman comme l’accession à une maturité recherchée dans l’adolescence où c’est la poésie (elle voulait peut-être dire le lyrisme en poésie) qui réveille en quelque sorte la vocation, admettant d’emblée que la pratique de l’écriture est autre chose qu’un simple penchant. Cette accumulation d’impressions au soleil levant et couchant ne remplit pas sa fonction d’explication et n’en marque peut-être même pas l’intention mais elle est symptomatique de notre époque où la philosophie, réduite à un conseil en éthique, ne promeut pas le texte littéraire au-delà de son seuil. Je ne sais pas si elle pensait à l’enfant en évoquant ce qui demeure une expérience personnelle et non pas une loi fondamentale de la littérature. Existe-t-il un enfant-hypothèse qui ne serait justement pas l’enfant-certitude des analyses psychologiques, un enfant hors-normes impossible à reconsidérer sous l’angle du ressentiment, pour ne pas dire de la haine, un enfant-homme de l’équité en matière de chance sociale ? Un enfant pré-poète qui laisserait une chance inouïe à l’homme-romancier (il ne peut s’agir dans ce cas que d’un homme-femme) ? L’adolescent y trouverait sa continuité morale ou la fin de sa tragédie. Ainsi s’expliquerait le suicide à quinze ou dix-sept ans. Je n’exagère que peu. L’amélioration ne serait proposée qu’à titre individuel, comme exemple à suivre en cas de crise. Aucune perspective institutionnelle n’affectait le propos aimable de cette grande romancière. S’agissait-il de simplifier un peu pour donner une leçon ou de préparer le terrain de la lecture pour en aplanir la difficulté ? La conversation des écrivains avec les autres n’est pas fiable au point de lui octroyer la justesse du texte lui-même. La parole, pourtant maîtresse en toute manifestation du langage hors du commun, a de ces glissements sentimentaux qui divisent pour permettre de mieux régner sur cette vie un peu à l’étroit dans le carré magique du roman. Un enfant transparent comme une vitre, impossible à fixer comme reflet de l’accouplement, un adolescent qui risque sa vie soit en la perdant, soit en ne devenant pas finalement le romancier promis à la secrète profondeur de soi, soit en demeurant le poète qu’il réussit à être, sorte de romancier raté : on en arrive à une conclusion presque à l’opposé de ce que le génie moins contestable de Faulkner a imposé au roman comme portail de la découverte romanesque : le romancier est une espèce de poète raté.
XIII
Une vision plus professorale, plus apte à la leçon, préfère installer l’épopée au moment de l’enfance. Un enfant-instantané d’on ne sait quel enracinement dans la culture environnante, cerveau plein d’aventures héroïques qui seraient comme la maturité des jeux ordinairement proposés à l’enfance pour meubler ses moments de vacances. L’idée de héros serait enfantine mais d’une enfance favorisée par telle ou telle entité qui demeure, tout de même, un mystère ou un choix. Puis, sans transition (on aime bien les coupures en milieu pédagogique), l’enfant-épopée apparaît en adolescent-lyrique à la recherche de sa moitié perdue dans des lieux non moins étranges, voire bizarres. Un peu comme si le héros, fatigué ou arrêté en cours de route par une vision de l’autre, s’agenouillait au pied de la figure-apparition qui reçoit les expressions de sa sentimentalité en état d’attente tremblante. Enfin, passée cette espèce d’initiation destinée à tuer l’enfant en attendant d’être le père ou la mère, une lumière est jetée plus ou moins nettement sur les choses de la vie et c’est alors une prosodie impeccable qui balaie toute velléité de cris de guerre et de soupirs. Encore un modèle plat, un applatissement d’une idée aussi bien exprimée qu’incertaine :
III-7
La théorie littéraire est pleine de ce genre de niaiseries destinées non pas à nous renseigner, en tant que géniteurs, sur les promesses de la littérature, mais à en tracer un cursus destiné à séduire : ------------- le sentiment du temps, douleur immense si rien n’est fait pour en atténuer les effets dans le cerveau de l’enfant ; ------------- le sentiment de la vie qui doit impérativement recommencer, à l’âge adulte, par le sentiment d’avoir atteint en même temps la maturité ; ------------- le sentiment de la littérature qui doit présenter une évolution maintenant garantie à la fois par l’exigence de maturité et par l’oubli des conditions d’attente les plus périlleuses, familialement parlant. Famille, honneur, patrie, comme on dit dans les démocraties conservatrices (de quoi justement ?) : mon oeil ! Héritage direct du bien, privilèges de la parole, terre prometteuse de possessions. Notons au passage que presque toutes les impasses littéraires du XXe siècle reposent sur une idée du temps jamais trop loin de cette vision de la chose sociale. D’où l’intérêt, peut-être, de s’intéresser à autre chose que le temps, en tout cas pas au temps de Proust par exemple. C’est en étranger au temps, pour commencer, que nous envisageons notre révolte relative à ces questions primordiales et détestables de l’amélioration de la race humaine. Une ontologie carabin/carabas suppose, une fois résolue la question de la pertinence d’une coupure épistémologique ou non, la conservation des découvertes utiles quand bien même elles ne seraient pas fondées à participer à une ontologie raisonnablement vraie : la conquête du pouvoir, l’hygiène mentale et la possession par dépossession ou invention demeurent les thèmes préférés de la conversation dont j’ai tenté de donner une idée pratique en écrivant CARABIN CARABAS.
XIV
Le personnage en prend de la graine, certes, et ne dispose plus de cette liberté que la friction des faits avec sa psychologie, pimentée d’imagination et de références, ne parvient plus à alimenter comme on nourrit le produit de sa propre chair. Quelle importance, les géniteurs (je parle du personnage qui a peu de chance de nous ressembler pour bénéficier de nos propres explications) ? Chaque fois qu’on se réfère au temps pour décrire ou simplement mettre en présence, on provoque une hâte bien compréhensible. Le personnage court. Le lecteur le ratrappe-t-il ? Le temps, linéaire ou recomposé selon des moyens somme toute assez précaires (qui exigent toutefois un talent hors-pair pour aller aussi loin), agit par capillarité, comme n’importe quel objet plongé dans un liquide : ce défi à la gravitation des immobiles dépend encore de la surface, de ce qu’on lui attribue de qualité c’est-à-dire de ce qu’on lui donne de sens. Acte d’écrire éminemment différent de la plongée du pinceau dans les magmas de la palette qui est comme le double essentiel du tableau. Avec le temps, tout s’en va, et n’en déplaise au poète de laboratoire, c’est encore le chansonnier qui a raison (sans doute parce que son inspiration est mieux nourrie que la crispation aléatoire du chercheur). Le pinceau agglutine le sens plus facilement que la langue posée comme un pied sur la littérature. Cette part de description, si elle n’entre pas dans le texte là où le personnage ne suffit plus à esquisser le roman, complique la lecture de celui qui sait lire la littérature et rend impossible la lecture à celui qui ne possède pas cet exercice de la statique mentale. Je ne sais pas en quoi la musique du texte contribue à sa compréhension et à son enrichissement. Il me semble que cette musique, par ses rythmes et ses dominantes, ne sert guère qu’à mémoriser le texte ou à rechercher les terrains sentimentaux destinés à former le lit de la lecture. Je ne pense pas que ce soit là ce qu’il convient d’emprunter à la musique pour complémenter un texte que les descriptions ne rendent pas à la réalité dont ils naissent. Or, c’est à la musique qu’on se réfère quand on prétend évaluer le style, quand bien même il ne s’agirait ni d’une musique sautillante (syncope) ni d’une musique militaire (cadence). Est-il si important que ça de bien écrire, c’est-à-dire d’écrire pour l’oreille, vieux fonds de rhétorique ou plus précisément d’une époque où on lisait à haute voix les textes proposés à l’esprit et où le discours, cadencé et gesticulant, empruntait les voix du monologue pour exercer son influence dans un auditoire privé du recours à l’intimité, condamné à poser des questions pertinentes. Le bien-écrire, l’écrire-style est une disposition d’acteur et non pas d’écrivain. Plus intéressant est le recours au vocabulaire, à sa connaissance (acte cognitif) comme à son invention (rhétorique), ce qui nous place dans le futur, dans ce qui va arriver aux mots pour influencer la phrase qui proposera des cristallisations claires à l’esprit en position d’écriture. On sent bien alors comment le héros n’est plus aussi facile à saisir que le voisin de palier surpris en flagrant délit d’existence quotidienne. Le chant, puisque c’en est un, est une question de mot et non pas d’éloquence. La maturité du savoir-faire-un-roman ne s’embarrasserait plus de l’effort de bien écrire, qui n’est pas donné à tout le monde, ni de bien recevoir ce qui est bien écrit, en connaissance de cause, en toute honnêteté, fût-elle le meilleur du romantisme. Un roman n’est pas un opéra. La maturité, s’il est bien question de cela en remplacement de la mort de l’enfant (qui la niera ?), est à ce prix.
XV
La révolte dont je parlais plus haut, qui s’en prend aux tentatives d’amélioration de l’homme, se nourrit (quel verbe et quelle action décisive !) d’un sentiment spatial du roman. La résultante est une enfance. Elle résulte, cette enfance, de ce futur rendu probable par sa promesse de textes et par l’instant si décisif, aliment de toute la vie, qui menace de tomber dans l’oubli, de ne pas signaler son importance au moment où le texte s’en approche, ou pire de ne rien laisser penser de son inévitable occurence. Si les liens de cause à effet ont leur importance dans la vie quotidienne (mon tiroir est vide : quelqu’un l’a vidé, moi ou un autre, anesthésie ou complot etc.), ce sont plutôt les ligatures d’effet à cause qui tracent le roman : le roman est une enquête ; ce n’est pas une intrigue bonne à mettre de l’animation dans l’ennui et non pas des raisons dans la révolte. Quel bonheur se serait de se surprendre soi-même en position de repos, loin de toute idée d’oscillation ou de translation ! Mais le bonheur, s’il doit exister dans ces conditions de combat incessant contre soi et les autres, serait plutôt relatif à la tranquillité. Bonheur des tranquilles (tranquillisés) et bonheur des immobiles (immobilisés par quoi ?). On voit bien là comment la substance tranquillisante prend le pas sur un effort nettement spirituel (auquel des religions nous convie dans un autre effort, celui de l’imitation). Substance devient le maître mot du présent à vivre sans pouvoir en mesurer l’instant ni en garantir la permanence, terrible fatalité du poète que ni l’éloquence ni la connaissance ne tireront de cet achoppement. L’entrée de la langue dans cet interstice est si proche d’un usage fétichiste de l’instant que les géniteurs, si c’est là leur importance, s’en émeuvent toujours à grands renforts de démonstrations de normalité tirées du répertoire des exemples à suivre. On ne s’étonnera donc pas que la querelle familiale, avec ses variations d’aventures sentimentales et ses emprunts à un éternel passé, prenne de l’importance dans la fabrication d’un roman. L’homme-enfant, qui appartient au passé, voyage dans l’homme-futur, qui est probablement (mais comment l’affirmer si l’enfant meurt ?) ce qu’il faut maintenant penser du passé.
III-8 - Le temps n’est plus qu’un espace romanesque.
Voilà comment s’opère le passage du vieux schéma où la vie est un "éveil" qui installe à leurs places respectives l’ignorant et le savant, celui-ci étant quelquefois chargé de "sauver" l’humanité d’on sait trop quelle faute sans laquelle il n’y a plus de religion ni d’approche philosophique de la religion, quand il est plus simple, mais c’est une autre histoire, de ne pas interposer entre les hommes les questions aux réponses tirées par les cheveux (Confucius), passage entre cette vieille figuration et la représentation romanesque qui, ne s’embarrassant pas de contraintes et ne contraignant personne à la lecture, suppose la vie comme une statique des forces en présence dans la relation humaine avec des savants contenus dans ce qui n’est plus une croyance mais une histoire et des cybériens contenant la science sans la connaître plus parfaitement que vulgarisée (jeu de hasard) ; Dieu non pas mort, car les idées ne disparaissent pas aussi facilement surtout quand les religions en assurent la persistance, mais réduit à ses prêtres, à la limite, à un filet de voix qu’il est bien inutile d’opposer aux poétiques et que les gesticulations d’acteurs n’améliorent que dans le jeu proposé au spectateur et non pas au lecteur. Le roman est une donnée qui participe avec le futur de l’homme encore enfant à cette enfance même qui finit comme s’achève le jour et la question du jour suivant n’est pas une question d’homme mais de maturité considérée comme la prémisse de la mort-retour à l’éveil qui sauva l’humanité de la vie pour la sauver encore jusqu’à ce que ce récit de l’enfantillage se termine en queue de poisson. Je préfère l’enfance, quand bien même il paraît impossible au premier abord de la distinguer de l’enfantillage et de sortir de soi un roman au lieu des babillages qui bornent l’esprit de nostalgies suggestives, de phobies théâtrales et de la leçon donnée aux enfants pour les sauver de la croissance au nom de Dieu ou du non-Dieu (qui quelquefois est tout simplement le Néant ou le non-Néant : chiasme).
XVI
Pensant moi aussi à sauver l’adulte de son histoire toute faite, il m’est arrivé, justement au sortir de l’enfance, alors que je me croyais un adolescent et qu’on me prenait déjà pour un adulte (tout avait parfaitement fonctionné), il m’est arrivé de me sauver de cette angoisse par le récit, ne sachant pas où il me menait une fois que je l’avais livré à l’écriture mais au fond assez confiant sur mes possibilités d’ouvrager quelque chose de lisible. Ce fut la Parabole du Festin. Je la livre ici dans sa division schématique, sans les articulations qui en définissent les nuances, sans les phases qui l’innervent dans les moments de doute traduit immédiatement par le garrotage de l’écriture :
------------1) X, de nuit de préférence pour ajouter au drame, se perd dans des rues vides de sens ; il rencontre l’impossible passant qui confirme sa folie d’X aux prises avec sa révolte ; la fuite se traduit par des vertiges d’ombres et de mots au sens difficilement explicable ; le poème est en lui, net comme l’eau, aimanté comme la fusion ; des fragments sortent de cette bouche livrée aux hasards de l’existence, aux rencontres d’un double qu’il s’agit de distinguer de l’original par le détail significatif ; l’entrée d’un patio se présente pour le sauver ; belle lumière d’une soirée entre amis ; le Gardien le conduit vers les tables surchargées de mets tous plus délicats les uns que les autres ; on ne lui demande pas : "Qui êtes-vous ?" et il ne s’en inquiète pas ; il se sent déjà appartenir à cette lumière, à ces visages, au ciel carré-noir-sur-fond-blanc qui limite les murs du patio ; il se nourrit lentement, au bord d’un bonheur rapide qui cisaille son angoisse ; on le frôle sans exiger l’existence ; il participe sans être de ce monde ; le poème continue de couler, sans douleur cette fois, comme s’il était possible, comme s’il fallait revenir ici chaque fois qu’il est question de trouver le repos, un repos immédiatement ressenti comme relatif, mais réel, presque omniprésent.
------------2) Les invités, dont on ne distingue pas encore l’hôte, l’hôtesse, les hôtes (comment savoir ?), se divertissent maintenant en racontant des histoires, chacun son tour méritant l’attention des autres qu’on voit agglutinés autour du conteur ; X se divertit lui aussi, passablement mais c’est là encore une réalité, la nième, qu’il convient de reconnaître pour ne pas se distinguer par une différence aussi indicible, si peu compatible avec la narration qui est de règle, on le rappelle entre chaque intervention : pas de rhétorique, pas de démonstrations abstraites, du récit, rien que du récit ; le poème, lui, continue sa croissance, comme s’il devenait urgent d’en parler et comme il est interdit d’en parler, il est nécessaire de le dire ; X s’approche comme un animal ; on le caresse comme s’il était effectivement un animal domestique ; il devine le plaisir dans ces distances non pas prudentes mais distraites ; les récits s’enchaînent sans interruptions autres que celles de Y qui secoue son index pour interdire l’abstraction ; "Pas d’explications, dit-il, nous ne voulons pas expliquer mais seulement raconter" ; Y n’est pas perçu comme étant l’hôte de cette soirée qui ne présente aucun signe d’étrangeté à part le fait qu’on peut y participer sans décliner son identité, sans avoir été invité, ce qui ne manque pas d’inquiéter X.
------------3) Voici X sur les trétaux ; il s’est inséré dans la file d’attente des narrateurs ; il s’est à peine excusé ; on ne lui même pas demandé d’attendre son tour ; récitant son poème, il ne cesse de penser à cette facilité ; il tente de se souvenir des visages au moment où il a pénétré cette attente joyeuse ; de temps en temps, le poème disparaît dans cette réflexion, absence presque douloureuse quand elle se signale par les chuchotements qui se superposent à l’annonce de la douleur ; revenu au poème, X retrouve le fil trop facilement ; il redoute de n’être plus lui-même ; il a vécu d’innombrables expériences de ce genre, où il s’est vu en représentant d’un autre jamais identifié ; peut-être ne s’agissait-il, comme dans les romans, que d’un effet de miroir ; mais ce n’est pas un miroir qui agit maintenant ; la timidité peut-être, l’inconstance des visages qui ne rient plus, semble-t-il, que pour se moquer ; où est Y ?
------------4) Là. Parmi eux. La pointe de son pied s’agite sur la dallage ; "Monsieur, finit-il par dire, j’avais dit pas de poésie !" Pas de poésie ? X s’interrompt à cette nouvelle ; il s’explique, n’ayant pas entendu que la poésie était hors jeu ; il dit aussi que son erreur est peut-être due au fait que c’est un poème qu’il avait en tête en entrant, un poème d’une influence telle qu’il n’a pas entendu les préceptes ; "Ce n’est pas grave," dit X. "Ça l’est, dit Y, en tout cas pour nous". Et tout le monde de l’approuver ; X descend du piédestal ; il se confond en excuses mais personne ne l’écoute ; quelqu’un a déjà pris sa place et l’assemblée ne prête plus attention au poète ; Y même se confond avec les autres ; "Ce pourrait-être n’importe lequel d’entre eux, pense X, sauf moi" ; désormais, il se tient à l’écart et de temps en temps il a l’impression qu’on s’intéresse à la courte distance qu’il impose aux autres comme s’il était chez lui et non pas ailleurs, dans le même monde, mais la nuit, au sein d’un festin dont il ne connaît même pas les raisons ; "Faut-il une raison pour être ensemble ?" etc.
------------5) Prêtant maintenant un peu plus d’attention à ce qui se raconte, X en perçoit la cohérence ; "Les autres, se dit-il, ce sont mes personnages. Non. Facile. Trop facile !" Le voilà en plein coeur de ce que les autres lui donnent à recomposer intimement pour comprendre parfaitement de quoi il est question ; tant de récits qui s’assemblent sans perdre la cohérence de leur ensemble trahit une nette volonté d’en faire le roman ; même Y s’est intégré à ce texte que sa présence ne fragmente plus ; X le cherche en pénétrant dans le cercle des auditeurs ; il sourit comme s’il était encore question d’excuser son importunité ; on lui sourit comme si on ne comprenait plus ; il ne leur demande pas : "De quoi parlez-vous ? Pourquoi un roman ?" ; Y est l’un d’entre eux ; "Ne craignent-ils plus la poésie à ce point ?" ; des serviteurs distribuent la nourriture compte tenu qu’on est tellement occupé à écouter qu’on ne s’approche plus des dessertes où la nourriture s’accumule, preuve qu’on mange beaucoup, "Que le roman donne faim !" se dit X en riant un peu trop visiblement.
------------6) Cette fois, c’est décidé, X entre dans le roman ; il n’envisage même pas une autre participation ; il entre comme il est entré dans le patio ; il s’y prend aussi impoliment, écartant la file d’attente sans ménagement ; une fois sur les tréteaux, il s’intègre à une cohérence dont il ne connaît pas les détails ; les visages semblent paisibles, comme s’il avait maintenant le pouvoir de passer du poème au roman sans susciter l’impatience ; il a la tentation de leur dire : "Si maintenant j’écris des romans, c’est parce que je continue avec vous ce que j’ai commencé tout seul !" ; mais bien sûr il ignore les raisons de cette intégration ; il ne réfléchit même pas aux conséquences de son acte ; il écrit des romans ; mieux, il écrit avec les autres, avec ces autres, sans connaissance du terrain, ne pensant pas au jour qui va se lever tôt ou tard, rien ne trouble sa nuit magique, son infraction aussi inexplicable que gratifiante ; il sait que pas plus tard que tout à l’heure, il sera encore question du désir et de ce que cela implique de perturbations au fil des jours ; entrer dans ce cycle des jours, ce n’est pas folichon peut-être, mais en attendant "Je prends mon pied en compagnie !", ce qui peut être considéré comme un net progrès, en tout cas comme une rémission.
------------7) C’est l’hôte qui l’interrompt cette fois ; il est accompagné du Gardien rencontré tout à l’heure sur le seuil ; "Je désire vous parler," dit l’hôte. "Vous désirez ?" "Il désire," dit le Gardien. L’hôte l’entraîne à l’écart : "Vous avez mangé ?" Comment dire le contraire, oui, X a mangé, peut-être même un peu plus que les autres ; et l’hôte lui propose d’avaler un antidote ; "La nourriture est empoisonnée ?" "Elle l’est, dit le Gardien, ils seront tous morts avant le lever du soleil" ; "Un assassinat, précise l’hôte, auquel vous n’étiez pas convié ; il ne faut pas se laisser attraper par les mots ; festin, assassinat, ça ne veut pas dire la même chose ; je sais de quoi je parle et vous saurez bientôt ce qu’il faut penser de cette anecdote, je veux dire de l’anecdote qui contient le roman."
XVII
Évidemment, il serait intéressant de comparer cette "version" avec l’originale écrite à 14 ou 15 ans et plus intéressant encore d’en suivre la parabole tout au long d’une vie bornée par les exercices littéraires et les démonstrations de savoir-faire. Les petits détails intentionnels nous renseigneraient sur le type de variation mis en jeu chaque fois qu’un peu d’âge a ajouté les nouveaux fruits de l’expérience. Je ne sais pas, et ne saurai sans doute jamais, à moins de le tenter et peut-être d’y perdre un temps précieux, si c’est là le moyen de re-construire une vie sans les moyens ordinaires de l’autobiographie, les moyens dérivés de la confession et ceux qui la protègent de trop d’indiscrétion et de conclusions contradictoires. Pousser l’oeuvre vers un aveu (J’avoue ou je confesse que j’ai vécu) me paraît être et devoir demeurer une espèce de trahison (Djuna Barnes à la parution posthume de ce qui est encore présenté comme les mémoires d’Hemingway). Le commentaire autobiographique ne peut pas servir de démonstration, pas plus que l’usage d’un temps littéraire, fervent de chronologie (et peu importe comment elle est rendue à la lecture), ne peut espérer autre chose qu’un sentiment de nostalgie conclu un peu vite par des traces de bonheur sur le visage maintenant mort. Ces impasses ont beau se présenter en conquérantes du style, elles ne vont pas plus loin que la conversation qu’on peut tenir avec l’autre ou avec les autres dans des circonstances d’analyse conjecturale, d’approche amoureuse ou de défense de soi. L’introspection et l’analyse, ce n’est pas nouveau, relèvent de la chanson, de la chose bien construite avec des matériaux qui, considérés isolément, semblent pouvoir appartenir à n’importe qui et au sujet de n’importe quoi. L’enfant du romancier, que ce soit celui qui est mort en lui ou celui dont il témoigne de la mort (qui précède, en scènes pathétiques, l’anecdote du festin), cet enfant est trop porteur de futur pour se laisser saisir au fil de poussées nostalgiques destinées, si l’on peut dire, à en tracer le portrait cinétique. Entre témoigner et romancer, il y va de la différencequiopère un sérieuxetinévitable clivage entre l’enfant et l’homme, le premier n’étant plus et le second étant peut-être-mais-quoi. C’est l’absortion de la Drogue (substance qui résout un problème) ou le refus de se droguer qui décident de l’avenir, ce qu’ici on appellera plutôt destin en face de ce hasard qui n’a pas fini (définition de l’infini) de nous interroger du haut d’une prépondérance mathématique qui l’éloigne tout de même un peu de ses usages littéraires. Entre l’Éveil et le Poème, des lois de composition d’une cruauté considérable fondent les circonstances de l’existence sans reconnaître un seul instant les signes annonciateurs d’une ontologie bien fondée en physique. L’Éveil utilise le temps dans d’interminables paraboles (Faulkner, plus profond et somme toute plus savant que Proust, ne s’y est pas trompé) et le Poème, reconstruisant en même temps tout le langage, n’en finit pas de donner une géométrie spatiale à un espace qui est aussi bien le fruit d’une expansion de l’univers compréhensible seulement avec des moyens mathématiques (abstraction) que d’une réflexion recursive qui conduit l’esprit dans les méandres circonstanciels d’une idéalisation porteuse de toutes les solitudes et mère de tous les anéantissements. Une grande capacité d’abstraction vous ouvrira les portes de la pyramide cognitive, trop de facteurs idéalisants vous conduiront tout droit à l’asile ou dans les rangs, en attendant l’asile ou la retraite, de la main-d’oeuvre industrielle et guerrière. Une éthique consisterait à déterminer les conditions du choix et à en dénoncer les inégalités de chance qui sautent aux yeux quand on jette un oeil sur la mentalité des géniteurs, sur les lois qui les composent et sur les constitutions qui en garantissent la meilleure application possible en empruntant sans scrupule les chemins de traverse des différences de statuts : riche, pauvre, bien, fou, fort, faible, mutualisé ou non etc. Encore faudrait-il que le Poème ne promette rien, ce que garantirait sa relation au hasard. Et faudrait-il qu’il ne fasse pas l’Histoire, piédestal des promesses. Au lieu d’ériger le récit de la passion sur la foi sans condition, et de le rédiger proprement, raisonnablement et en toute cohérence, commettant peut-être un chef-d’oeuvre mais traçant toutefois les limites à ne pas dépasser (versets perdus ou sataniques par exemple), il s’agirait assez naïvement de pénétrer le texte pour en retrouver les fondements et pourquoi pas la théorie. Ceci suppose une technique indifférente à l’acte d’écrire. Est-ce concevable ? Ce serait de l’analyse, de l’introspection, de la déconstruction... Tout ceci a-t-il déjà donné quelque chose ? Pas qu’on sache et nous ne voulons pas croire aux complots des Gardiens de l’humanité au détriment du progrès scientifique. Ce qui place la littérature en posture de science probable, ni exacte ni fausse, probable, ce qui lui va comme un gant. Trouver et non pas chercher, en tout cas en partant de JE. Que reste-t-il alors des autres ? Un poème, même en passant par le Festin qui le contraint au roman pour des raisons à la fois très claires et d’autres parfaitement obscures ? Nous approfondirons, au plus, et sans doute, ce n’est pas paradoxal, par le moyen des surfaces.
III-9 ... /... La quatrième partie sera publiée dans un prochain numéro de la RAL,M. |
|||
|
|
|
Revue d'Art et de Littérature, Musique - Espaces d'auteurs | [Contact e-mail] |